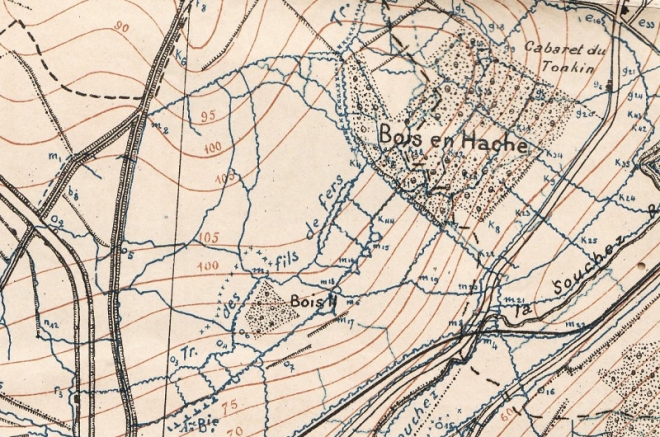Matinée chargée… En fait, vous aurez même droit aujourd’hui à deux en une !
Ce matin, STOC au sud de la ville. Cinq points en rive gauche du Rhône, cinq points en rive droite et rien de bien passionnant. Les conditions étaient bonnes, j’étais sur place au lever du soleil… Est-ce à cause de la fraîcheur matinale ? Les oiseaux peinaient à se mettre en route. J’espérais le Rougequeue à front blanc – je n’en ai eu qu’un. La Huppe : zéro. Les gros arbres sont pourtant toujours là. Deux roitelets, de rares Mésanges noires. Bref, les forestiers, dans ce joli quartier très arboré, m’ont fait faux bond. J’ai dû me contenter de quelques banalités.
A Gerland, il semble que l’Hirondelle de fenêtre ait définitivement disparu. Il est vrai que presque tous les bâtiments qui l’accueillaient ont été rasés. Sur les autres, on ne voit que l’auréole grisâtre laissée par des nids détruits depuis longtemps. De manière générale, l’espèce est en train de quitter Lyon, définitivement. Nous ne parvenons pas à sauver les colonies lors de travaux. Malgré nos tentatives, nos poses de nichoirs, elles ne se réinstallent pas. Il semble que les populations ne soient pas assez dynamiques pour surmonter ces mauvaises passes.
La recette est pourtant éprouvée. Soit un bâtiment occupé par des nids d’Hirondelles, et nécessitant rénovation. L’espèce est protégée, menacée : que faire ?
On commence par ôter les nids, en hiver bien sûr, quand ils sont vides. Et on les remplace par des nichoirs, posés le plus près possible et avec une exposition aussi proche que possible. Ces nichoirs sont des imitations de nids naturels, construits en béton de bois. Ensuite, si les travaux ne doivent pas commencer de suite, on rend inaccessibles par des bâches ou des filets l’emplacement des nids retirés. Il ne s’agirait pas que les oiseaux se mettent à rebâtir précisément là où l’on doit procéder aux travaux.
De la sorte, les Hirondelles sont empêchées de nicher sur la bâtisse à rénover, mais grâce aux nichoirs, elles peuvent rester « sur zone » en s’épargnant le coût de la construction ou de la rénovation des nids. Car, oui, cela a un coût ; un coût énergétique bien sûr : imaginez le travail que représente la construction de ces échauguettes d’argile, pastille après pastille, avec juste un bec minuscule en guise tout à la fois de pelle, de toupie à béton et de truelle ! Ajoutez-y qu’en ville, trouver de la boue, de la bonne boue homologuée nid d’hirondelle devient un véritable défi… Bref, le nichoir est un pied à l’étrier indispensable.

Nichoirs pour Hirondelles de fenêtre, avec leur planchette anti-salissures
Ainsi, l’année des travaux, si tout va bien, une nidification a tout de même lieu dans le secteur. La colonie reste fixée, et dès l’année prochaine, elle pourra recoloniser son ancien domaine.
Bien sûr, toute la démarche doit s’effectuer avec l’appui de connaisseurs, qui sauront déterminer le nombre et l’emplacement des nichoirs, et le tout être validé par les services de l’Etat. Car il s’agit d’une destruction intentionnelle de nids d’espèce protégée. La loi garantit aux citoyens que le premier pékin venu ne peut détruire ainsi le patrimoine commun. Pas question, donc, de jouer à ça chez vous, en douce.
Voilà, on fait tout cela et normalement, ça marche.
A condition que les oiseaux reviennent, et qu’ils trouvent assez d’insectes volants à proximité, que le printemps ne soit pas trop pourri, que…
Moyennant quoi, de plus en plus souvent, cela ne marche pas et la colonie est perdue à jamais.
On tâche désormais d’augmenter encore les chances de réussite en adjoignant aux nichoirs un « système de repasse » – un petit haut-parleur à batterie, ou mieux, solaire, qui diffuse en avril des cris d’hirondelles pour attirer les migrateurs. Il semble que les retours d’expérience soient bons. Mais vous voyez la complexité de l’ensemble.
Nous n’avons pas le choix : les populations d’hirondelles sont si fragiles qu’on ne peut plus se permettre de perdre les grosses colonies comme cela.
Dix heures. Me voici cette fois-ci en banlieue, au pied d’un haut pylône, pour une « surveillance Pèlerin ». De quoi s’agit-il ?
Le Faucon pèlerin fait partie des rares espèces qui se portent mieux qu’il y a trente ans. Certainement pas par hasard : il a fait l’objet d’un effort de protection gigantesque, alors qu’il avait pratiquement disparu d’Europe moyenne sous les coups de la chasse et du DDT. C’était l’époque où le lait des femmes françaises contenait tant de résidus toxiques qu’il aurait été classé impropre à la consommation si l’on avait voulu le vendre… Interdiction de certains pesticides, surveillance des nids, récupération-soins-relâcher de poussins faméliques voués à la mort, tout cela a permis aux populations de se refaire la cerise et recoloniser le gros de leurs territoires perdus. Mais au bout du compte, cela ne représente jamais que 1400 à 1500 couples. Trois mille oiseaux sur cinquante-cinq millions d’hectares…
Dans la région, ayant occupé la plupart des falaises – sauf celles occupées par les Hiboux grands-ducs, qui sont leurs prédateurs – les Pèlerins tendent, timidement, à s’installer en ville. La table y est servie en abondance de merles, d’étourneaux et de pigeons ; reste à trouver une corniche du pauvre sur ces curieuses falaises faites de main d’homme. Et voilà un couple sur une grosse antenne de communications. L’ennui, c’est l’envol des jeunes. Ils sont plutôt patauds et leur sortie du nid ressemble plus à une chute contrôlée qu’à un essor majestueux. Imaginez un gros poulet fouettant l’air de ces deux machins pleins de plumes que la Nature lui a vissés sur le dos, perché sur sa plateforme, et plaf ! voilà qu’il perd l’équilibre.
Lorsqu’il dégringole d’un nid installé sur une belle et bonne falaise, pas de problème : il y aura toujours une vire, un saillant pour le recevoir quelques étages plus bas. En ville, c’est une autre affaire, et l’aspirant prédateur risque fort d’échouer piteusement au sol, à la merci du premier chat ou malandrin venu. D’où la nécessité impérieuse d’organiser une surveillance permanente à la saison des envols, pour récupérer ces maladroits et les replacer en hauteur. Une fois, deux fois, cinq fois…

Un jeune Faucon pèlerin récupéré au sol et replacé sur un toit
Cette année, nous avons de la chance, et pour l’heure, les trois poussins que nous suivons ont réussi seuls leur premier envol. Ils ont sauté, ont échoué sur un toit en contrebas, et presque immédiatement réussi à redécoller, à prendre de l’altitude par leurs propres moyens. Pour eux, c’est gagné. Du moins, notre responsabilité s’arrête là. Ils passeront quelques semaines encore sous la dépendance des adultes, à parfaire leur technique de chasse, avant la dispersion définitive.
Évidemment on n’emporte pas son bouquin pendant ces veilles interminables : surtout quand on est seul, il s’agit de ne pas quitter la lucarne des yeux pendant trois heures. Ce n’est donc pas là que j’ai terminé la lecture du « Travail invisible » (de Pierre-Yves Gomez), mais difficile de ne pas y repenser tandis qu’on rumine, face au pylône dans lequel les poussins dorment. De quoi prolonger un peu la réflexion entamée à l’épisode 11.
Un vrai travail, cela doit être utile aux autres, lit-on dans le témoignage qui conclut ce livre. Suis-je utile, à veiller au grain, ou plutôt au pèlerin, au pied d’un immeuble ? Je ne crée pas de richesse (financière) ni d’emplois. La plupart de mes concitoyens sont totalement indifférents à la survie en France de l’espèce Faucon pèlerin, que d’ailleurs ils ne voient pas, lors même qu’elle évolue au-dessus de leur tête.
Je le crois utile, évidemment, sinon je ne le ferais pas. Vous avez sûrement remarqué que ma saison de terrain consiste assez rarement à prospecter les recoins verts du département ; je me retrouve plus souvent sur des sites assez peu pittoresques. Encore ne voyez-vous là que la saison de terrain, le cœur de l’activité certes, là où naît la vocation d’un tel métier, mais je n’y passe, grosso modo, qu’un tiers de mon temps de travail annuel. A peine. Tous les matins de mi-mars à mi-juin, quelques autres demi-journées éparses ; le reste est consacré à l’analyse, à la rédaction, aux dossiers de protection, à la coordination des réseaux de bénévoles, aux bases de données. Bref, ce métier n’est pas une bucolique sinécure au point qu’on choisisse de l’exercer juste pour ça. C’est un métier que l’on fait avec plaisir, bien sûr, voire, parfois, avec bonheur ; mais c’est bien un travail, et pas du tout une espèce de loisir rémunéré ; même si c’est une passion, c’est aussi un service. Bien sûr, on y vient parce qu’on aime observer la Nature et qu’on veut que cela puisse durer ; mais ce serait bien réducteur d’en conclure qu’on ne l’exerce que pour soi.
À cause de nous, des milliers d’espèces ne rendront plus gloire à Dieu par leur existence et ne pourront plus nous communiquer leur propre message. Nous n’en avons pas le droit.
(Laudato Si, point 33)
En tout cas, même si tout le monde s’en f… lorsqu’un jeune Faucon pèlerin a réussi son envol, je me sens heureux, pas seulement par émerveillement personnel, un brin égoïste, d’assister à ses cabrioles, mais aussi d’avoir participé à le donner à la Nature de l’an 2016, à l’avifaune de la ville, à mes concitoyens. Et je voudrais, souvent, lorsque je l’aperçois perché sur son antenne, leur dire : regardez ! mais regardez ! c’est un Faucon pèlerin. Vous savez, l’oiseau-bombe dont vous avez lu avec stupeur et ravissement qu’il faisait du 300 à l’heure ? et bien il y en a un là, au-dessus de votre tête, au-dessus de notre parcours quotidien arpenté les épaules voûtées et l’œil sombre.
De même, je suis heureux d’avoir découvert ce Petit-duc dans la Loire (c’était l’épisode 14), où il n’était pas connu. Non pas fier – puisqu’il s’agit d’une découverte fortuite – mais juste content d’avoir ainsi pu révéler sa présence aux collègues qui, du coup, pourront veiller sur lui en quelque sorte, prendre soin de cette part de patrimoine vivant commun. Vu les menaces qui pèsent sur la biodiversité, il est sage de la connaître aussi finement que possible. Cela figure même dans la Doctrine sociale de l’Eglise, au point 42 de Laudato Si, bien entendu.
« Produire » de la conservation de la biodiversité. Travail invisible, dont d’aucuns croient, d’ailleurs, qu’il s’accomplit tout seul, sans savoir quels yeux ont veillé dans l’ombre, quelles mains ont travaillé pour que l’oiseau soit encore là à chanter ce matin.
C’est notre façon, dans ce métier, de « produire » quelque chose qu’à défaut de consensus sociétal, nous croyons utile aux autres.